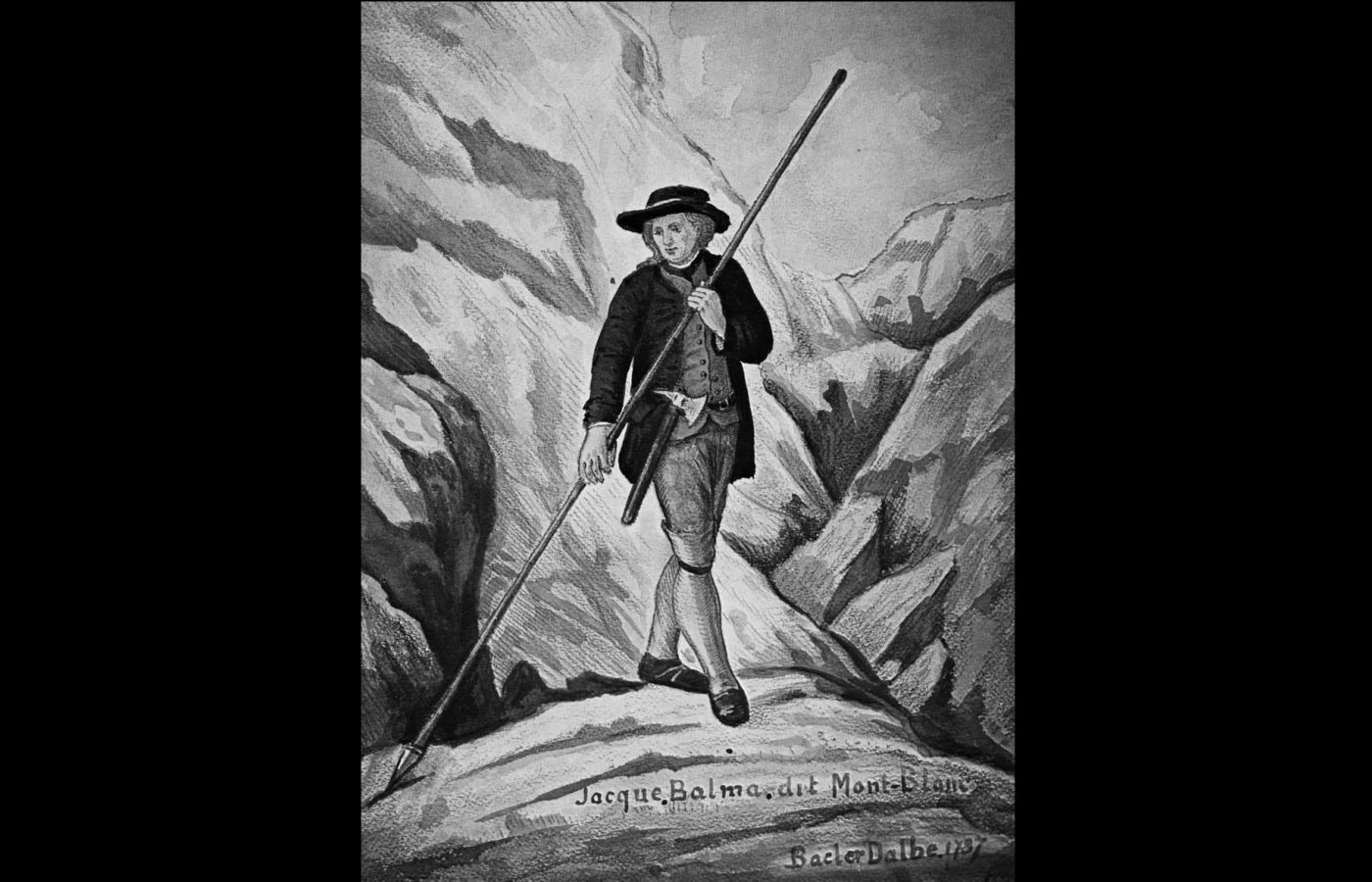En alpage, de l’aube au crépuscule
L’agriculture, Les métiers

Le jour n’est pas levé quand les bergers commencent leur travail. C’est l’heure de la traite. Tout juste sortis de leur couchette et avant même d’avoir avalé un bol de lait, les bergers ont lié le bottacul à leur ceinture, empoigné le seillon et, les mains enduites de graisse à traire, se dirigent vers les écuries. La traite manuelle est longue, il est indispensable de garder, matin et soir et tout au long de la saison d’estive, le même ordre de passage. Les bêtes sont nerveuses, leurs mamelles gonflées de lait sont douloureuses : attention aux coups de pied et aux coups de queue qui renversent le seillon de lait. Aussitôt tiré, le lait est transvasé dans le chaudron de cuivre avec le lait de la veille conservé au frédié.
L’article en images

L’heure de la traite à Loriaz

Le frédié où le lait est maintenu au frais

Le chaudron de cuivre où cuit le lait

La chavanne de Blaitière Dessous en 1947

Les bergers de Lognan en 1950

Le fruitier de la Pendant
La journée du fruitier.
Travaillant, comme les autres employés de la montagne, sous contrôle des procureurs, le « fruitier » fabrique le fruit de l’alpage, le fromage. Il a fait de son métier une spécialité, il touchera le plus gros salaire. Au début du XIXe siècle, à Blaitière, on appelle « grivier » ce fromager qui fabrique du « griviere« . Ses gages s’élèvent à 44 Livres, plus du double du séracier (chargé de la fabrication du sérac). Le maître-berger ne touche que 30 Livres, le petit berger et le berger des chèvres : 13 Livres et 10 Sols. À La Flégère, en 1784, Jean Michel Bossonney est fruitier et touche 33 Livres, tandis que Jean Antoine Couttet, berger, n’en touche que 10.
Premier des domestiques, c’est lui qui aura le meilleur gage car de la qualité de son travail, de ses compétences, acquises par la pratique avec d’autres fromagers, dépend la qualité du fromage. Il œuvre d’un alpage à l’autre, selon les saisons ; mais qu’il vienne du Val d’Aoste, du Valais ou de Tarentaise, sa bonne réputation le suit. Son honnêteté et sa vaillance lui permettent de choisir ses employeurs, les consorts, qui lui donneront le meilleur gage et la chavanne la plus moderne. Son environnement de travail, généralement très rustique, rend la tâche pénible. À lui de préférer des locaux bien entretenus et sains, offrant des outils de travail en bon état : un chaudron de cuivre propre, suspendu à une crémaillère solide, un conduit de cheminée au-dessus de l’âtre…
Le plus haut placé dans la hiérarchie de la chavanne, le fuitier doit tenir les comptes concernant le lait et le sérac consommé et faire payer au consommateur. En 1801, à Balme, le lait se vend par écuëllée pour 3 sols en monnaie de Savoye. Il rend ensuite ses comptes au procureur qui lui-même rend ses comptes aux consorts.
Le lait de la traite de la veille est conservé au « frédié« , reposant dans des « goveillons« , vastes baquets semi-immergés dans un bassin où coule l’eau glaciale amenée par la bédière. La bonne conservation du lait est impérative et le frédié, petite annexe à la chavanne, est soigné. En 1911, l’assemblée générale de Balme élit trois membres, Messieurs Comte, Simond et Combaty, chargés d’exécuter ou de faire exécuter un bâtiment devant servir à refroidir le lait.
Ce lait s’est couvert pendant la nuit d’une épaisse couche de crème. D’un habile coup de poignet, le fruitier la cueille, à l’aide de sa large spatule de bois : elle sera battue dans la baratte pour former une délicieuse motte de beurre parfumé. En 1887, les consorts de Balme font l’acquisition d’une baratte à beurre tournante. C’est un achat largement justifié pour cet alpage qui emmontagne 140 vaches laitières et dont les comptes de la saison feront ressortir une production de 840 kg de lait par jour. 600 kg de beurre y sont barattés dans l’été. Mais attention, le réglement précise que le beurre ne pourra se faire « qu’avec les florettes, et la première crème, ce qui ne portera pas préjudice au fromage. »
Le lait du matin et celui de la veille sont ensuite versés dans le chaudron pour y être chauffés. Le bois nécessaire a été ramassé et empilé, prêt pour le feu. Cette tâche est la plupart du temps partagée par les « domestiques« , qui prélèvent dans la forêt voisine, propriété des consorts, bois mort, branches cassées et autres arbustes envahissants. Entretenir la forêt, débroussailler et défricher mais sans compromettre l’avenir… À Balme, un « bûcheron » est spécialement désigné pour « la fourniture du bois à consumer annuellement et qu’il devra en fournir la moitié en bruyères soit rodindrons (sic) ou autres broussailles aux fins de défricher peu à peu ladite montagne ».
La délicate – et un peu magique – transformation du lait en fromage commence. Le fruitier chauffe le lait, y ajoutant la « caillette » au moment opportun. Une tête d’épicéa soigneusement écorcé fait office, parfois, de tranche-caillé : les grains fins pourront rendre plus facilement leur eau pendant la suite de la cuisson. Puis, en un geste large et précis, le fruitier ramasse dans une toile les précieux grains qu’il déposera dans un moule où ils seront pressés et égouttés.
Récupéré au sortir de la presse, le petit-lait est destiné à la fabrication du sérac (du latin seraceum = partie séreuse du lait, petit-lait) modeste fromage maigre qui a donné son nom aux énormes blocs de glace en équilibre instable sur les glaciers. Le séracier prend la suite du fruitier et recommence l’opération avec le petit-lait qu’il fait à nouveau chauffer et cailler pour obtenir le sérac, base de l’alimentation des alpagistes.
Le résidu de cette deuxième cuisson, pourtant vidé de toute propriété nutritive, n’est pas jeté pour autant mais versé dans l’auge des porcs qui s’en régalent.
Une fois compressé et égoutté, le futur fromage est démoulé et immergé dans un bain de saumure pendant vingt-quatre heures puis entreposé sur un « trabla » de la cave où commence sa lente maturation. À Balme, un saleur est responsable de cette délicate opération. La température et l’humidité constante de ce local semi-enterré permet une bonne conservation de la meule frottée deux fois par jour d’une toile humide de saumure. La pâte s’imprègne progressivement de sel tandis que se constitue, à l’extérieur, la croûte dure qui participe à la conservation du délicieux gruyère de montagne aux arômes subtils. Il faudra attendre la désalpe pour la distribution des meules qui pèsent de douze à vingt kilos.
Le troupeau, resté à la pâture durant la journée, doit être rentré pour la traite de l’après-midi et la nuit. S’ils ont eu un moment de détente à la mi-journée, les bergers sont à nouveau sollicités. Certaines bêtes récalcitrantes refusent d’obéir, il faut les appâter. Les bergers portent une besace emplie d’un mélange de son et de sel, dont les vaches sont gourmandes. Cette friandise, offerte dans le creux de la main, calme les plus rebelles.
Elément de conservation des aliments, le sel est précieux. Les comptes de l’alpage de Balme font mention de grosses quantités achetées : 225 kilos en 1912, 375 kilos en 1917, 450 kilos en 1918 !
La bénédiction des alpages
Si les jours de beau temps apportent beaucoup de bien-être au bétail et aux bergers, il n’en est pas de même du mauvais temps, pluie, orage et grêle ou même neige, parfois. En altitude, les conditions météorologiques sont plus marquées, les changements plus brusques. Un été pluvieux peut s’avérer assez catastrophique et ruiner la saison d’estive. Il n’est pas étonnant que les hauteurs soient protégées d’une croix, d’un oratoire.
À Lognan, la croix est emportée par une avalanche en 1914. Mais la chavanne a été préservée. Par la grâce de Dieu ? Année après année, décennie après décennie, la croix de Lognan, sobre et modeste, est toujours là, l’une remplaçant l’autre. La dernière, bénie par l’abbé Gérard Ravanel, d’une famille de consorts, date de 1988. La croix de la Flégère figure sur les plus anciennes lithographies et a gardé sa place, en dépit des travaux de construction du téléphérique ou d’agrandissement du pavillon devenu refuge. Grâce au talent de Gaby Croz, une nouvelle croix est mise en place à Pormenaz, dominant les chalets, en 1983. À Loriaz, la Croix est juchée sur un rocher à la sortie de la forêt.
En montagne, face à une nature pas toujours clémente et faute de mieux, on implore rituellement la protection divine pour s’assurer une meilleure sécurité. Ainsi, en 1690, Monseigneur Jean d’Arenthon d’Alex, évêque de Genève à Annecy, est sollicité par les habitants de Chamonix pour venir « exorcicer et bénir les Montagnes de glace » dont la « hauteur semble porter leurs pointes jusque dans les nües et elles s’élèvent presque autant que la veüe peut porter. » Celui-ci accède à leur demande : « Ouy, mes bons amys, j’iray quand je m’y devrois faire porter, pour joindre mes prières aux vostres« .
Dans ce même état d’esprit, la bénédiction des alpages est régulièrement demandée par les consorts pour protéger les bergers et les troupeaux. « Dans le courant de juillet, le curé ou son vicaire fait plusieurs tournées dans la paroisse et visite successivement tous les hameaux et les divers groupes de chalets. (…) Il bénit le sel, puis l’eau et fait l’eau bénite. (…) Il bénit la salle et l’étable. Le sel est ensuite donné à manger aux bêtes ; « mais on en garde toujours un peu pour leur en donner en cas de maladie. Souvent les gens dissimulent sur la table, derrière les bols, un petit écheveau de laine qui profite de la bénédiction. Lorsque les bêtes sont malades on leur attache aux cornes un peu de cette laine. (…) Le curé bénit les montagnes en officiant devant une grande croix en bois plantée dans le voisinage. » À Vallorcine, on fait célébrer une messe à l’église pour la protection du bétail. Le curé sera payé en fromage.
Le bétail malade
Ce n’est pas fréquent, mais il arrive que les vaches soient malades en alpage. Cette situation est toujours vécue comme une catastrophe par le propriétaire. Une laitière coûte cher, et la faire soigner aussi. C’est pourquoi les « reconnaissances » adoucissent un peu la charge du propriétaire. En 1932, à Lognan, on estime que le repas pris à la montagne peut être gratuit pour la personne qui vient soigner une bête, comme pour une journée dédiée à la communauté par un consort.
Les procureurs et les bergers sont tenus, par crainte de laisser se propager une contagion, de soigner l’animal malade et, parallèlement, d’en aviser son propriétaire. Il faut parfois appeler le vétérinaire. Celui qui monte à Blaitière en 1790 coûte 6 Livres et 8 sols. Pour « droguer » la vache, on a acheté du poivre et du vinaigre. Quand la vache succombe, on trouve des arrangements pour que son propriétaire ne perde pas tout, selon la date de sa mort, début, mi ou fin de saison.